Le Cadran ligné sera le week-end aux Rencontres de poésie Jour & Nuit à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), avec un beau programme de lectures, musique, expositions, et un marché d’éditeurs de qualité. Venez nombreux.
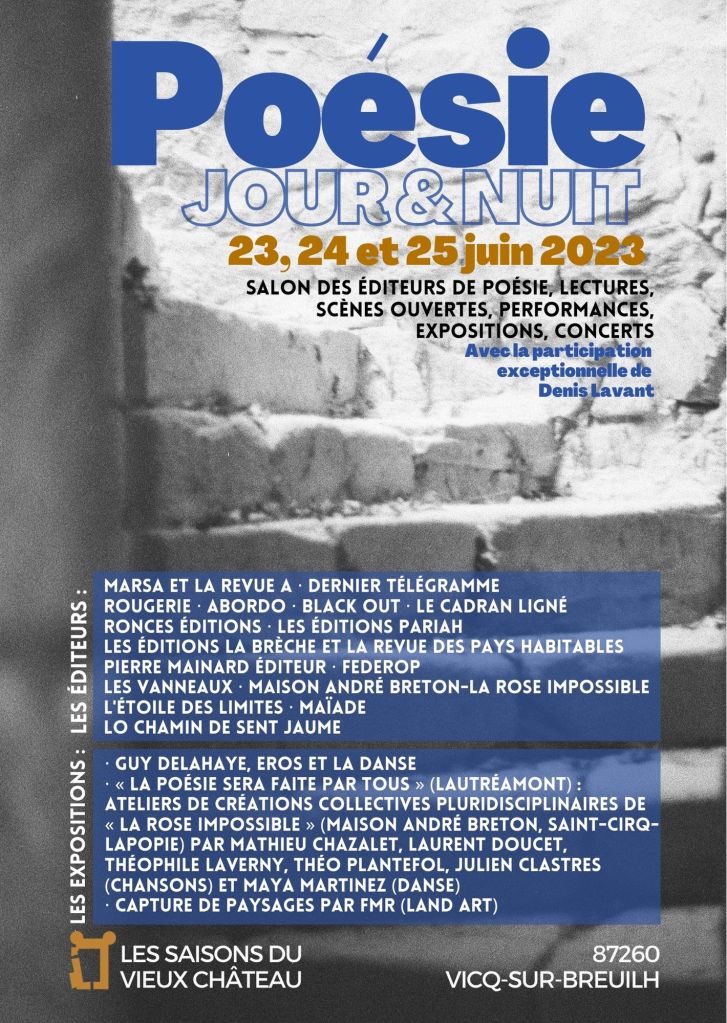

Le Cadran ligné sera le week-end aux Rencontres de poésie Jour & Nuit à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), avec un beau programme de lectures, musique, expositions, et un marché d’éditeurs de qualité. Venez nombreux.
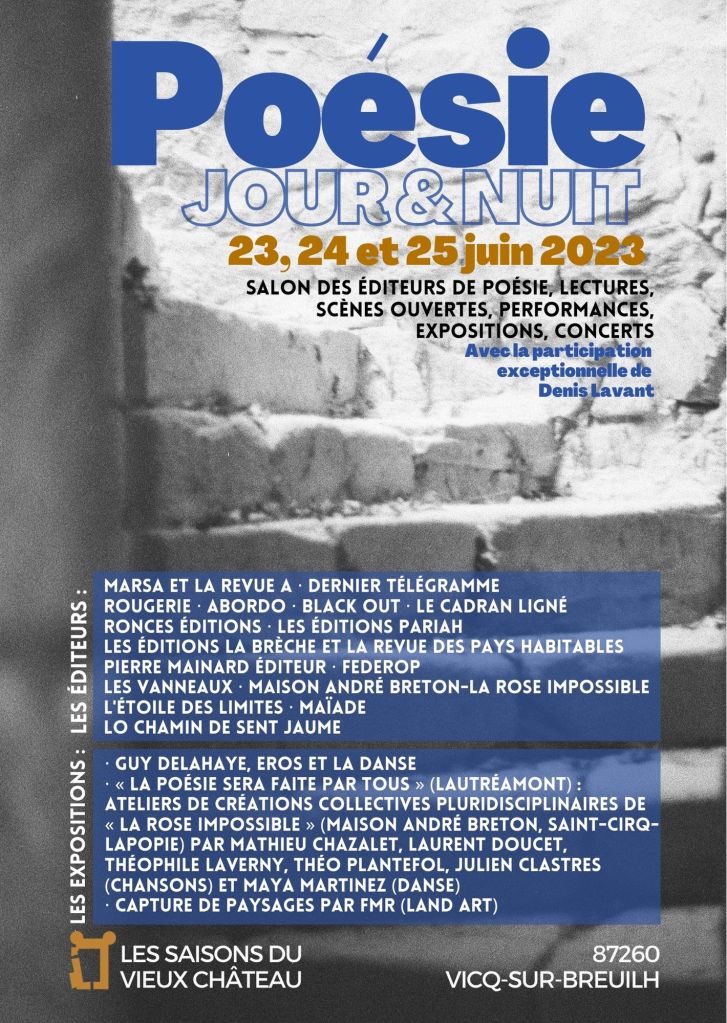

Merci à Guillaume Contré et Sylvain Tanquerel pour ce très bel entretien à propos du Vent dans les arbres, paru dans Le Matricule des anges n° 244 (juin 2023) :


Un grand merci à Jean-Claude Leroy qui propose une très belle note de lecture consacrée au livre de Cécile A. Holdban. La note a paru sur le site de Poesibao. Extrait :
« Cécile A. Holdban les appelle osselets, c’est une forme brève qui se déplie comme une fleur, éclate comme le jour dans la nuit. Réussite salubre que cette économie suivie où s’attrape une idée qu’il s’agit de ne pas laisser retomber pour et par rien. Une ligne ou deux, ou trois, suffisent pour livrer une image éloquente, l’image étant ici un lieu où être. À sa suite, une autre image vient s’y ajouter, sur le même thème, car le livre est séquencé par quelques rubriques – Minos, nuagier, échelle, larmier, ricochets, silence, etc. – si bien que le même poème se déroule sur quelques pages, tout en étant une suite de « stations » ou de fenêtres.
Loin d’être un simple jeu de formes ou de sens, ces aphorismes (oui) relèvent de l’analogie aussi bien que de la connaissance, puisque celle-là produisant celle-ci. On est là au niveau du meilleur Malcolm de Chazal ou encore d’Antonio Porchia, lequel est d’ailleurs cité en exergue de Nuagier.
Baume en même temps qu’éclaircissement ; l’effet de dévoilement opère, nous mettant face à une réalité redéfinie que la magie des mots a bien voulu nous indiquer, comme pour ouvrir un nouvel espace ou un nouveau point de vue. N’est-ce pas là un des rôles de ce que, dans le domaine de la poésie comme dans celui de l’art, nous appelons gaillardement « création » ? Proposer de nouveaux angles et ouvrir, ouvrir, encore ouvrir. » Jean-Claude Leroy
L’intégralité de ce compte-rendu ici.

Cet entretien a été mené par Rodolphe Perez pour la revue Zone critique. Je remercie Rodolphe Perez pour son attention et ces questions.
Créée en 2009 et dirigée par Laurent Albarracin, la maison des éditions du Cadran ligné poursuit un travail remarquable de poésie. Elle s’attache à défendre une poésie plurielle et exigeante. Retour sur son parcours et ses projets avec son éditeur dans le cadre du dossier consacré aux éditions de poésie.

Rodolphe Perez : Vous dirigez les éditions Le Cadran ligné, une maison située en Corrèze, et fondée en 2009. Qu’est-ce qui a appelé en vous la création de cette maison ? On peut, il me semble, distinguer au moins deux périodes dans la vie de la maison. D’abord cette des « livres d’un seul poème », série de plaquettes de 75 titres, puis une série de livres. Qu’est-ce qui a présidé à ces temporalités et pourquoi vous concentrer aujourd’hui exclusivement sur les livres ?
Laurent Albarracin : La maison d’édition est née d’abord d’une envie de partager mes goûts en poésie. Lorsque j’ai commencé en 2009 avec les « livres d’un seul poème » (des plaquettes constituées d’un feuillet plié en quatre et prise dans une couverture vergée), mon idée était de faire circuler des poèmes de poètes amis ou que je lisais. Je ne pensais pas alors devenir vraiment éditeur, mais simplement donner un reflet de mes lectures, faire exister des poèmes à l’intérieur d’un cercle amical. J’ai ainsi publié 75 titres de 75 auteurs différents. Puis je me suis pris au jeu, des opportunités ont fait que j’ai franchi le pas pour fabriquer un premier vrai livre, puis un deuxième, jusqu’à maintenant publier une série de trois livres par an. La collection de « livres d’un seul poème » ne pouvait pas durer indéfiniment, les livres sont venus comme naturellement remplacer cette collection. L’état d’esprit est d’ailleurs à peu près le même : il s’agit de rendre compte de mes préoccupations poétiques. Et, puisque j’employais le terme de collection, mon activité d’éditeur s’apparente un peu à celle d’un collectionneur cherchant à s’entourer d’œuvres qui lui plaisent, qui font sens en tout cas pour moi dans ma recherche personnelle. Les ouvrages que j’édite sont un peu comme des livres amis des miens. La simple différence entre les livres et les plaquettes est que les livres sont plus faciles à diffuser que les plaquettes, vouées plus ou moins à demeurer dans une certaine confidentialité, ne serait-ce que parce que les libraires – on les comprend – ne savent pas trop quoi faire de ces objets-là.
Rodolphe Perez : Dans un entretien accordé à Pierre Vinclair, pour Diacritik, vous évoquiez au printemps dernier votre place dans cette cartographie de l’édition de poésie. « Si mes éditions sont confidentielles, et revendiquées telles, c’est surtout en ce sens qu’elles échappent à toute logique de marché et à toute considération ou recherche de succès commercial […]. » Il est évident que la logique de marché, notamment spéculative, peut entraîner des choix éditoriaux tapageurs ou mauvais. A l’endroit de quoi vous répondez par une position en marge, et c’est, comme chez d’autres éditeurs, une position aussi qualitative. Comment cela se conjugue dans la gestion d’une maison comme Le Cadran ligné ?

Laurent Albarracin : L’objectif étant de rester à l’équilibre financier, il s’agit de s’arranger pour ne pas perdre d’argent. L’aide du CNL est d’ailleurs souvent bienvenue, étant entendue qu’elle ne conditionne pas le choix des livres que je publie. Quant à la diffusion en librairie, que je n’assure pas autant qu’il le faudrait faute de temps, elle est restreinte, mais je compte sur les notes de lecture et articles critiques pour qu’au moins les lecteurs intéressés par les auteurs que j’édite, ou avides de découvertes, soient au courant des publications et puissent les commander en librairie (les livres sont distribués par Le Comptoir du livre SPE). Quant à la marginalité, elle est le lot commun de tous les petits éditeurs dans mon genre – surtout en poésie – qui occupent forcément une position marginale par rapport au marché du livre et qui n’ont pas d’autre boussole que de faire primer la qualité sur la rentabilité – du moins on l’espère. Cette position en marge est d’ailleurs assez confortable et c’est pourquoi je ne me plains pas vraiment du peu d’audience de la poésie dans les médias. Elle est aussi un gage de liberté. On fait ce qu’on veut, on veut ce qu’on fait. On le veut d’un vouloir assez passionné pour continuer coûte que coûte.
Rodolphe Perez : Pour évoquer plus précisément la poésie, comment singularisez-vous vos choix d’éditeur ? De même que, poète, comment équilibrez-vous ces deux jambes de votre rapport à la poésie ?
Laurent Albarracin : Je marche sur deux jambes, et même sur trois si l’on inclut mes notes critiques. Mais cela s’équilibre assez naturellement. Il me semble que mes activités se nourrissent les unes des autres. Écrire, éditer, parler d’autres livres d’un point de vue critique, participer à une revue comme Catastrophes que Pierre Vinclair, Guillaume Condello et moi-même animons, tout cela procède d’un même mouvement. La poésie a besoin d’échanges, on n’est pas sourds à ce qui se passe alentour. Personne n’est une île, comme disait l’autre, mais c’est une banalité. On pourrait se représenter la chose ainsi : il y a mon écriture poétique au centre ; mon travail d’éditeur en serait un écho, le plus proche peut-être ; puis mes notes critiques constitueraient un cercle plus large, plus ouvert et curieux. Cela pour dire que mes choix d’éditeur et mon activité critique partent d’un même foyer où brûle une seule et unique quête.
Rodolphe Perez : Vous évoquiez, toujours auprès de Pierre Vinclair, ceci : « En poésie, je ne crois guère qu’à l’image poétique, en tant qu’elle est un instrument de connaissance, que ce soit comme puissance d’effraction ou comme outil de spéculation métaphysique. » Est-ce à dire que pour vous l’image poétique – là votre filiation surréaliste, pas exclusivement toutefois – déplace le réel pour mieux l’ouvrir ? La pluralité de votre approche témoigne en tout cas d’un catalogue heureusement irréductible à quelques adjectifs.
Laurent Albarracin : Il n’est pas si facile de caractériser la ligne éditoriale du Cadran ligné. Je dirais pourtant que l’imagination me semble être au cœur de l’affaire, avec des variations selon les auteurs, des variants et radiants s’étendant dans diverses directions. Il y aurait un axe important du côté des vertiges et des puissances de l’analogie (Wolowiec, Rassov, Savitzkaya, Alain Roussel, Beeckman), un autre du côté d’une certaine quête ontologique (Jacqmin, Nuñez Tolin), un parti-pris chosiste dans la lignée de Ponge (Le Goff), un goût pour le merveilleux naturel (Tanquerel et Backes, Cornuault), pour les rêveries contemplatives et méditatives à partir de la nature (Ducos, Holdban, Viguié), quelque chose aussi qui irait vers les jeux logiques à l’œuvre dans le langage (Ana Tot, Silvia Majerska). Et puis il y a encore certains prosateurs qui savent jouer merveilleusement des richesses de la langue française (Bergounioux, Graciano, Prieux). On peut accrocher comme je viens de le faire les auteurs de la maison à l’une de ces branches mais ils ont vite fait, comme l’écureuil vif ou le singe malin, de sauter d’une branche à une autre. Jean-Pierre Le Goff, par exemple, j’aurais envie de le mettre un peu partout.
Rodolphe Perez : Si personne n’est une île, il y a toutefois quelque chose de l’archipel dans ces lieux intimes et libres qui se rassemblent et rassemblent. De même que votre approche et éditoriale et critique semble précisément viser à cette définition – inachevé et mouvante parce que vivante – de vos perspectives de réflexions. « Collectionneur », dites-vous, en ce que prime l’hétérogène. Aussi, au-delà de l’évidente subjectivité à l’œuvre, comment cela se passe d’un point de vue pratique ? Quels sont les aspects qui vous attirent et attisent face à un texte ?
Laurent Albarracin : Dans la notion de collection, il y a sans doute l’idée de l’hétérogène, mais aussi une certaine recherche de cohérence. Mais je suis peut-être le seul à voir de la cohérence dans mon catalogue ! Je ne saurais dire ce qui m’attire dans un texte. Sans doute le plaisir de reconnaître une voix propre à l’auteur et qui pourtant correspond à ma sensibilité poétique. Le plus jouissif pour un éditeur est bien sûr de découvrir un nouvel auteur. Ce fut le cas pour moi avec Boris Wolowiec et Victor Rassov, deux poètes dont j’aurais édité les tout premiers livres. Ils ont tous deux une manière qui n’est qu’à eux, mais qui à mes yeux opère un pont avec mon écriture ou avec celle de tel autre poète que j’aime. Victor Rassov pouvant être situé par exemple quelque part entre Savitzkaya (pour la préciosité presque baroque de son écriture et un goût affirmé pour le bas, le corporel) et François Jacqmin (pour une même coexistence du concret et de l’abstrait dans le poème). Ceci dit, c’est toujours le caractère irréductible d’une écriture à une autre qui en fait la valeur, et c’est toujours un mystère de savoir pourquoi elle nous touche, comment elle bouscule notre vision des choses, etc.

Rodolphe Perez : De même, comment dissociez-vous ou conjuguez-vous votre rapport à la note critique et votre rapport à l’édition ?
Laurent Albarracin : Je les conjugue plutôt que je ne les dissocie. Ce sont deux activités qui n’ont rien de contradictoire à mes yeux, elles sont complémentaires. Il faut juste trouver le temps de faire les deux, ce qui n’est pas toujours évident. Quand je dis qu’elles sont complémentaires, c’est qu’une même intention les anime. De même que je n’édite que ce que j’aime, j’écris des notes de lecture seulement sur ce qui me plaît. Je ne suis pas un critique professionnel et je me garde généralement d’émettre un jugement sur tel ou tel ouvrage. Il s’agit plutôt d’entrer dans une écriture et de la faire résonner avec mes préoccupations personnelles. Coucher sur le papier les impressions qu’on a à la lecture d’un livre permet de mieux l’appréhender pour soi. Au fond, si je suis un éditeur et un critique, c’est uniquement pour continuer d’affiner mon sentiment poétique des choses, en élargissant certes le cercle de ma curiosité mais, encore une fois, parce que cela répond à une recherche qui m’appartient. Le risque est évidemment de faire un contresens et il faut essayer de l’éviter. Mais en même temps il est bon et bénéfique je crois de partir de sa propre expérience de la poésie pour en parler.
Rodolphe Perez : Quels sont les projets, actuels et à venir, de la maison ?
Laurent Albarracin : Il y a eu ce printemps deux recueils de poèmes, d’Anne-Marie Beeckman et Cécile A. Holdban, et des textes inédits de l’extraordinaire et trop méconnu surréaliste qu’était Jean-Pierre Le Goff (1942-2012). L’an prochain ce sera une suite au « Grand Poème » de Marc Graciano et des recueils de Serge Nuñez Tolin et Patrick Wateau. Viendront ensuite des livres de Victor Rassov, Jean-Paul Michel et de nouveaux inédits de Jean-Pierre Le Goff.
Le Cadran ligné sera présent au Marché de la poésie place Saint-Sulpice, Paris 6e, du mercredi 7 juin au dimanche 11 juin, en compagnie des éditions Dernier télégramme, stand 613. J’y serai pour ma part à compter du vendredi et j’aurai grand plaisir à vous y retrouver. Vous pourrez y rencontrer certains de nos auteurs, au gré de leurs passages sur le stand.
Et découvrir les trois nouveautés de ce printemps :



https://lecadranligne.wordpress.com/les-poings-cardinaux/
https://lecadranligne.wordpress.com/osselets/
https://lecadranligne.wordpress.com/le-vent-dans-les-arbres-et-autres-textes/
∇
Mercredi 7 juin : 14h-21h30
Jeudi 8 juin : 11h30-21h30
Vendredi 9 juin : 11h30-21h30
Samedi 10 juin : 11h30-21h30
Dimanche 11 juin : 11h30-20h
Sur Remue.net, Jacques Josse livre une excellente note de lecture à propos de l’ouvrage de Jean-Pierre Le Goff paru récemment à nos éditions.
On ne peut s’empêcher de copier intégralement ce qu’il en dit :
Récits de Jean-Pierre Le Goff
Il y a de quoi être fortement impressionné, presque sans voix, inquiet quant à trouver les mots justes pour dire le foisonnement, la densité, la richesse d’un tel livre : 400 pages rassemblant des textes écrits entre la fin des années 1970 et le milieu des années 80, une décennie durant laquelle Jean-Pierre Le Goff (1942-2012) n’aura pas chômé.
Le plus étonnant est de voir que l’auteur, rivé à ses pensées, à ses découvertes, à ses interrogations quotidiennes, à ses flâneries intempestives, à ses promenades imaginaires ou réelles, à sa curiosité exacerbée, écrivait et construisait ses récits posément, patiemment, sans éprouver le besoin de les publier. Il en donnait bien quelques-uns aux revues amies, notamment à Camouflage, qu’animait Jimmy Gladiator, mais la plupart restaient dans ses dossiers. C’est dans ceux-ci, conservés à la Bibliothèque des Capucins à Brest, que Sylvain Tanquerel est allé puiser pour concevoir cet ensemble.
Il a exploré le fonds Le Goff, s’est concentré sur le premier versant de l’œuvre, cette période où, fasciné par des objets divers, par les bruits, les bruissements, par ses virées ferroviaires, par la friabilité des ailes des papillons ou par la triste domestication des violettes, il donnait libre cours à sa pensée et aux rêveries qu’il conduisait à sa guise, les guidant en douceur mais avec exigence et abnégation. Cet homme est aux aguets. C’est sa vocation première. Rien ne doit lui échapper. Et tout ce qu’il découvre doit lui permettre d’ouvrir ses fenêtres intérieures et de se propulser là où son cerveau l’appelle. Quand il évoque « Le vent dans les arbres », il se porte instantanément à hauteur de branches, frissonne avec les feuilles, interroge le tronc, les racines, la cime, se demande ce qu’en pense les habitants du lieu, les oiseaux, les fleurs, les fruits et quelles sont les motivations de ce visiteur invisible et aérien aux humeurs si changeantes.
« Selon Léonard de Vinci le regardeur peut voir dans les taches des murs des images qui parlent à son esprit et entendre dans le bruit des cloches des sons que l’imagination interprète ; de même dans le bruit du vent dans les arbres des sonorités différentes se reconnaissent : murmure de rivière, pluie, ressac. »
Suivent vingt pages magiques où il avance, les écoutilles grandes ouvertes, à l’écoute du moindre son, créant, par fragments, un étonnant puzzle de notes avec l’intuition « que les mots sont à l’esprit ce que les arbres sont au vent ».
Il nous invite, dans la foulée, à une marche lente et minutieuse au cœur de la forêt. Le lieu, mystérieux, regorge de surprises. Il les détecte avec une certaine gourmandise et se fait un plaisir de mettre sa pensée et son imaginaire à l’épreuve. Plus tard, c’est en tronçonneur de branches, lors d’un été pluvieux dans le Jura, qu’on le retrouve en train de détecter les traces, les signes, les pictogrammes inscrits sur le bois par des insectes dits « typographes ».
« J’ai appris qu’une personne pouvait retrouver dans ces tracés tout l’alphabet hébraïque. »
De fil en aiguille, poursuivant ses flâneries, il s’empare d’un bâton pour tenir en main un « petit morceau » de forêt. Il emprunte ainsi à l’arbre l’un de ses membres et s’emploie à donner vie à ce bout de bois en l’interrogeant, en cherchant ce qui se cache derrière l’écorce.
« Le bâton semble établir un courant entre le promeneur et le fond végétal dans lequel il baigne. »
Jean-Pierre Le Goff aime également se confronter, avec joie, tout comme le fit jadis Francis Ponge, à nombre d’objets ordinaires. Il étudie leur forme, leur physique, leur spécificité. À leur contact, il affine sa pensée et souligne leur incomparable présence, qu’ils soient billes, bols, hélice, cailloux égarés, barque, bouteilles consignées ou bulle de savon.
« La bulle de savon est une sphère. La géométrie démontre qu’il n’y a pas de surface plus réduite que la sphère pour contenir un espace donné. »
Méthodique, facétieux, heureux de circuler dans les spirales de sa pensée, Le Goff apprécie tout particulièrement le chemin de fer. Attendre sur un quai de gare ou se laisser porter par le rythme lancinant d’un train lui procurent des sensations différentes et complémentaires. Cela l’incite à écrire des « miettes ferroviaires » qui glissent sur les pages de ses carnets.
« L’attente est agréable.
Les rails font des écarts.
Les voyageurs ne les voient pas. »
Il y a matière à bouger en soi, à lire, à découvrir, à sentir, à partager dans cet ouvrage aux multiples portes d’entrée. Il est bon de le garder à portée de main. De l’ouvrir au hasard. Et de se laisser happer par l’écriture posée, ample, enveloppante de ce grand discret qui aura passé sa vie à détecter les vibrations infimes qui fondent l’être humain en le rattachant à son environnement immédiat, quelque soit le lieu où il se trouve,
Jean-Pierre Le Goff : Le vent dans les arbres, édition établie et postfacée par Sylvain Tanquerel,
Jacques Josse
30 mai 2023
https://remue.net/le-vent-dans-les-arbres

Un grand merci à Pierre Gondran dit Remoux qui donne une très belle lecture du livre de Cécile A. Holdban sur Poesibao.
Extrait :
« Ma mère jouait très bien aux osselets et, de son enfance campagnarde, elle se remémorait les authentiques os de tarse de mouton d’alors — que le jeu rendait peu à peu moins organiques, plus abstraits. Jouer avec le concret des choses, Cécile A. Holdban nous y invite en dix poèmes (« Nuagier », « Échelle », « Ricochets », « Silence », « Origamis »…) comme autant de figures de lancer d’osselets. Adresse, méthode, itération, telles sont les qualités qu’elle réunit dans un objectif si modeste qu’il n’en est rien moins que phénoménologique : dire quelques-unes des choses à dire du monde timide qui l’entoure. Les appeler par leur nom. Tenter de les faire s’approcher de soi dans la langue. Réduire la distance.
« La goutte fait déborder le vase
le mot submerge la voix
Entre la fleur et sa pensée
il n’y a plus de tige »
Pour cela, l’autrice orfèvre monte et sertit le nuage, le chemin, l’écume, la goutte… d’un fil syntaxique le plus délicat et discret possible. Aussi utilise-t-elle des énoncés parémiques (au tour limpide de proverbes, d’aphorismes) ou scientifiques (à l’axiomatique concise, mais également aux figures d’analogie, qui sont nombreuses en sciences quoi qu’on en dise), deux styles d’énoncés mis tout entier au service du référentiel — la chose du monde. »
La suite à lire sur Poesibao : https://www.poesibao.fr/cecile-a-holdban-osselets-lu-par-pierre-gondran-dit-remoux/

Marc Wetzel « divague d’enthousiasme » à propos de Le Vent dans les arbres de Jean-Pierre Le Goff :
« S’il est vrai que notre poète entre dans ses thèmes pour y stationner compulsivement, y scrupuleusement piétiner, puis y juger souverainement, trois choses sont à décharge de cet esprit hors-normes : d’abord, l’acuité se sait contagieuse, et se veut ainsi généreuse : Le Goff n’explore, pour tous, l’inconnu que par hasard arrivé premier sur lui. Il réfléchissait en nous y attendant, voilà tout (il met son courage intellectuel à disposition, et préempter l’inédit n’est pas dans sa nature). Ensuite, il vise le plein emploi de la présence au monde : morts, il ne nous sera plus loisible de méditer ce qui nous arrête, ce qui nous distrait, ce qui nous échappe (les chapitres sur “l’interruption”, “l’inattention” et “l’approche du secret”, ainsi, sont formidablement nuancés et éclairants). Enfin, qui reprocherait à un ogre de lucide disponibilité d’entrer dévorer nos … enfantillages ? Dans l’étonnant chapitre sur “les incidences et impromptus d’une lecture”, Le Goff, sous couvert de s’apprendre à mieux lire autrui (on ne saura pas qui), nous éduque à le déchiffrer. On lira, dans les extraits qui suivent, de décisives notations sur – respectivement – la pluralité, la délicatesse, la fidélité, l’humilité, la suggestivité, l’infaillibilité, la familiarité, et enfin (trois fois) l’indéfinité de l’activité de lire.
(Après le “Traité de la poussière” de François Jacqmin, l’éditeur Albarracin ajoute à sa collection un aussi considérable monolithe. Jean-Pierre Le Goff est, réellement, Plume et Teste, Caillois et François d’Assise, Ponge et Starobinski, ou même – pardon de divaguer d’enthousiasme – Breton et Alain).
“Mon esprit s’est fixé sur des objets matériels qui peuvent traduire au plus juste certains appels, certaines trajectoires que nous faisons en nous-mêmes. L’île c’est nous, la carte est notre être et le lieu où le coffre est enterré est celui de notre possible réalisation” Rutilance du trésor, p.380) »
Sa recension est à lire sur Poesibao.

Un immense merci à Patrick Corneau qui consacre une très large partie de sa chronique aux nouveautés du Cadran ligné.
Extraits :
(…) Cécile A. Holdban peintre, poétesse et traductrice (une dizaine de livres publiés), vient nous rappeler avec ces Osselets que le dire poétique reste une grande forme de la pensée et que lui seul peut nous confronter véritablement aux puissances du langage. Avec une phrase ou deux, en deux lignes ou trois, un peu à la façon du haïku, le poème rassemble ici une collection de choses impondérables, fragiles, fuyantes : nuage, larme, pluie, arbre, oiseau… Choses sensibles “qui font battre le cœur”. Pas l’objet en soi, inaccessible, mais plus précieux peut-être : la trace fugace, l’empreinte ténue que l’heur, l’humeur, l’otium ont bien voulu déposer. Soit l’épiphanie de la sensation vraie, imprévisible, illuminante par laquelle le monde entre en nous. Parfois, le poème se hausse à la sapience, risque une manière d’aphorisme en hommage à Antonio Porchia (cité en tête de “Nuagier”) :
Le temps coule toujours
dans le sens inverse
de l’eau que l’on boit
Le vrai silence est vertical
Mélange ton alphabet à celui des graminées
ton ombre sera plus légère
(…)
De Jean-Pierre Le Goff (1942-2012) : Le vent dans les arbres, une compilation de textes écrits entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980 absolument subjuguante. J’avais beaucoup aimé Journal de neiges réédité l’année dernière par Librairie La Brèche éditions dans une version augmentée. Ici le poète se confronte à des objets de fascination aussi divers que les ailes de papillon, le fil à couper le beurre, la bulle de savon, le vent dans les arbres, la couleur rouge, etc. Il s’agit de s’attarder rêveusement sur des événements d’apparence insignifiante, de « tordre le cou à la banalité de l’utilitaire » pour libérer des facultés poétiques comprimées par la « rationalité quotidienne ». Ce sont donc autant de rêveries où l’écriture semble jaillir comme par réverbération au contact des choses, et qui sont autant de coups de sonde dans les propres paysages intérieurs du poète. Car chez Jean-Pierre Le Goff les sources mêmes de l’émerveillement ne se déprennent jamais d’une physique sensible où affleure une étrangeté qui demande à être élucidée.
Il y a dans cet ensemble quelques textes de nature plus conceptuelle, réflexive dont je m’étonne que la très informée postface de Sylvain Tanquerel, le maître d’œuvre de cette édition, n’ait pas signalé l’exceptionnel intérêt. « Incidence et impromptu d’une lecture » vaut à lui seul l’acquisition du livre : 27 pages de réflexions d’une finesse saisissante sur ce qu’est lire. Il y a de sagaces études universitaires sur la réception des textes littéraires, la sociologie de la lecture, etc. En revanche peu de choses sur la pragmatique de la lecture, comme si persistait un point aveugle, une résistance à ouvrir cette boîte noire désormais chasse-gardée du cognitivisme. Ce que fait Jean-Pierre Le Goff prenant acte de l’aporie de la lecture, prolongement de celle du langage qui à la fois nous accueille et nous écarte. J’ai rarement lu remarques plus intelligentes (excepté peut-être chez Jean Starobinski), plus bouleversantes même, sur cette dramaturgie de la compréhension, de la prise de sens qui se joue entre auteur et lecteur. C’est une épreuve hautement agonistique, un combat obscur, incertain, dans lequel le lecteur se sent toujours en infériorité, en proie au doute, au sentiment d’imposture même, lesté de ses nombreux biais et insuffisances (inculture, admiration aveugle, identification, idée fixe, projections, fantasmes, inattention, bêtise, etc.). A mesure que la réflexion de Jean-Pierre Le Goff progresse, elle se fait poésie car elle seule comporte dans le surcroît de sens qu’elle offre la promesse de nous porter au-delà du seuil où elle-même nous dépose :
« Comme la caresse à rebrousse-poil d’un chat dans l’obscurité produit des étincelles, mon esprit empêtré dans son moule tire de la lecture uniquement des crépitements de sens fugitifs.
Feux follets et lueurs qui, à peine saisis, seraient gommés à une vitesse fulgurante de ma mémoire par je ne sais quelle opération.
Ou bien cela est d’une importance extrême ou bien cela est imbécillité totale. L’imbécillité et la sagesse la plus pure sont peut-être inextricablement mêlées.
Chaque phrase demanderait une bibliothèque de commentaires. »
Aux prises avec « le démon de la formulation » qui n’est pas moins terrible que le dragon de la compréhension par laquelle la pensée donne corps au sens, Jean-Pierre Le Goff tentera un saut proprement insensé dans l’interruption de l’écriture au profit d’une sorte d’herméticité du geste artiste, d’une poésie d’actes, de lieux et de signes, considérée comme l’une des aventures intellectuelles les plus étonnantes de son temps. Saluons donc l’émergence de cette prolixe et passionnante partie de l’œuvre avant le mutisme.
L’intégralité de cette note est à lire sur le blog Le Lorgnon mélancolique.
« Le vent dans les arbres – près de 400 pages d’une prose attentive aux choses et à leur réfraction dans la langue. Le Goff tourne autour des choses, les retourne, les traverse, s’y pose, s’y dépose : avec l’humilité de celui qui sait le réel à la fois opaque et transparent.
Ces choses n’en sont parfois pas : je veux dire par là que les sujets qu’aborde (et parfois saborde) Le Goff peuvent être aussi bien le pli d’une jupe qu’un moment d’inattention, le mystère de la gomme ou le craquement d’une armoire.
A chaque fois, il s’agit d’appréhender, mais sans déformer, sans trop arracher le sujet à son mutique terreau. Comment parler du trou ? Comment le décrire sans y choir ?
(…)
Voici un recueil qu’il faudrait mettre entre toutes mains susceptibles d’écrire. Modeste dans son approche bien qu’audacieux dans le choix de ses motifs, Le vent dans les arbres est une incroyable boîte à outils qui, sous couvert d’études de cas, met à nu (et en jeu) le travail de l’écriture poétique: faire de l’apparemment indicible un événement dans la langue. »
La note dans son intégralité est à consulter ici.
